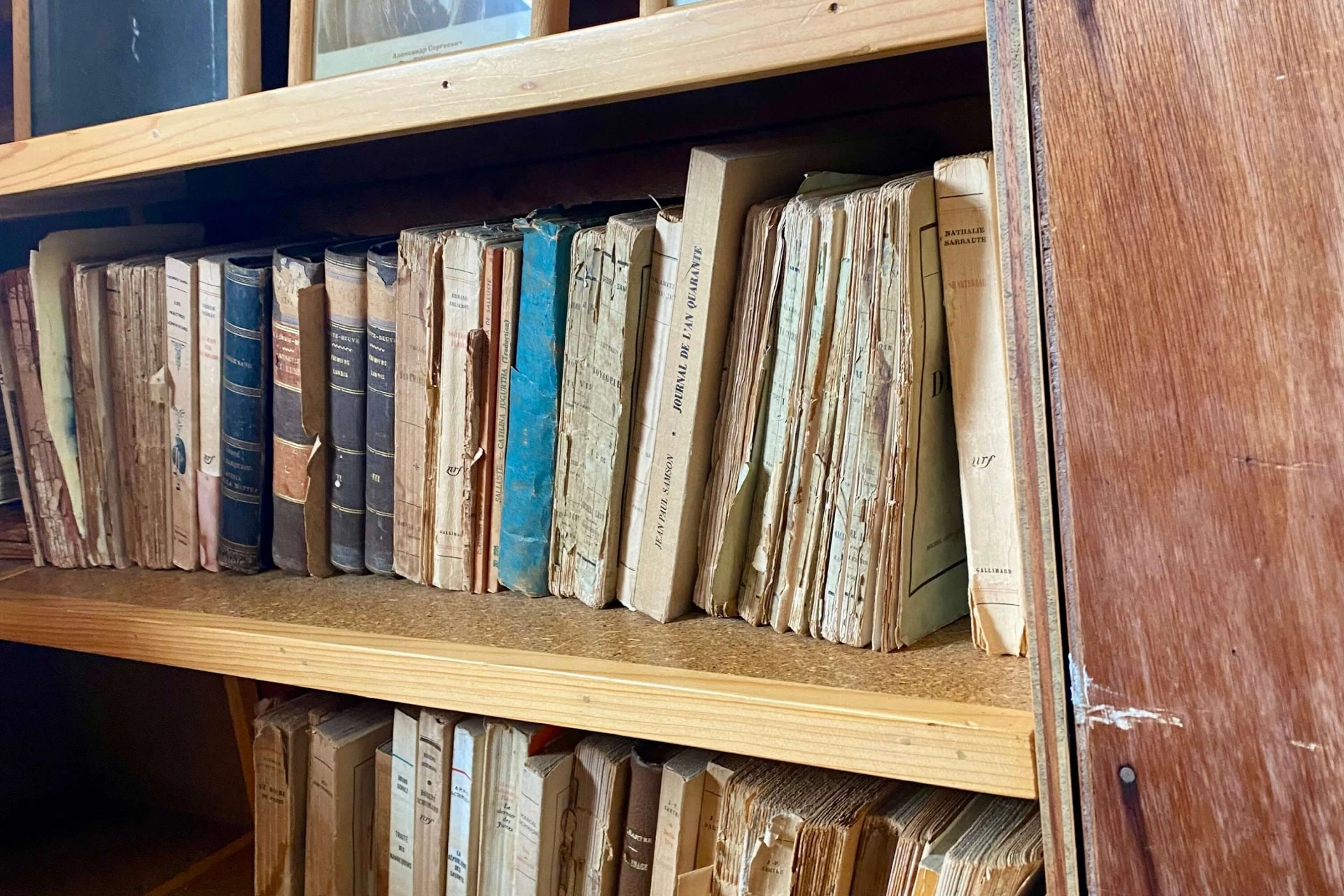Le Genius loci des Jeux Olympiques de Paris 2024
Autrice : Célia Boucheraux Publié le : 18 juillet 2025 Lecture : 4 min
Il est peu probable que vous ayez échappé à quelques images des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se sont déroulés l’été dernier en plein Paris. Pour la première fois, une ville hôte a décidé, non seulement d’organiser les Jeux dans la ville, mais surtout d’utiliser des lieux déjà existants et iconiques, en les réinterpretant et les adaptant. L’occasion de faire vivre l’esprit des lieux d’une nouvelle manière, d’utiliser l’histoire des lieux pour les ancrer dans le présent, en créant de nouvelles images, de nouveaux souvenirs, à partir de lieux déjà inscrits dans la mémoire collective. Focus non exhaustif sur les plus symboliques.
La scène de la Seine
Les Jeux ont démarré en trombe, inaugurés par une cérémonie qui a eu lieu pour la première fois en dehors d’un stade. Et pour ce spectacle la scène choisie a été… la bien nommée Seine. Au-delà de l’homophone facile, l’intérêt principal de ce choix est d’avoir pu retracer à travers différents tableaux, l’histoire de la ville en remontant le cours de son fleuve. On est passé du Paris Moyenâgeux, avec l’iconique Notre-Dame et ses bruits, en écho aux cloches mythiques, au Paris révolutionnaire, du Paris artistique, au Paris politique.
Ce parcours a été rendu possible par la formation même de la ville. Comme beaucoup d’autres, Paris s’est construite depuis son cours d’eau, lieu de travail et d’échanges par excellence, qu’ils soient commerciaux ou culturels. Point toujours central de la ville, les limites et couronnes de Paris se sont petit à petit éloignées au fil du temps, ce qui permet aujourd’hui une certaine lecture de l’histoire de la ville depuis ses berges, toujours centrales.
À noter que des parades sur la Seine, bien que rares, ont déjà eu lieu, notamment pour l’anniversaire de l’appel du 18 juin 1945.
L'envolée olympique de la Flamme-Montgolfière aux Tuileries
Une des images iconique de ces Jeux est certainement la Flamme emportée dans sa Montgolfière, brûlant le ciel de Paris. Un écho direct au premiers vols de ballons qui se sont déroulés au parc des Tuileries en 1783… mais pas par les frères Montgolfières.
C’est bien le physicien Jacques Charles qui fit décoller le premier ballon, gonflé à l’hydrogène depuis les Tuileries mais quelques jours plus tard, les frères Montgolifier font voler le leur, gonflé d’air chaud. Ce seront eux qui présenteront leur vol au roi et ce sont surtout eux qui réussiront le premier vol habité, garantissant ainsi la postérité de leur nom. Jacques Charles exécutera pourtant son premier vol habité qu’une dizaine de jours plus tard, avec un ballon plus technique, toujours depuis les Tuileries. C’est également lui qui inventa la plupart des équipements encore utilisés aujourd’hui.
Depuis, les Tuileries sont régulièrement utilisées pour des envolées de ballons, avec des êtres humains et maintenant, aussi des flammes.
Le marathon pour tous dans les pas des femmes révolutionnaires
Le marathon de cette édition des JO a lui été marqué de plusieurs nouveautés. D’abord, une version de la course a été ouverte à tout le monde, en dehors du pré-requis sportif habituel de l’événement, l’occasion d’en faire une course populaire dans un événement de sport professionnel (ou de niveau professionnel). Ensuite, c’est le marathon féminin qui a clôturé l’événement, dans le but de promouvoir la pratique sportive féminine, de lui donner de l’espace, dans une discipline où les femmes ont par le passé tenté de s’inscrire avant de se faire expulser des courses des JO. Ces deux choix sont en écho avec le tracé même choisi pour le déroulé de la course. En faisant une boucle de Paris à Versailles, en passant devant monuments et espaces verts iconiques de la région, il reprend le cheminement de la marche des Femmes de 1789, un événement historique déterminant pour l’histoire de Paris mais aussi celle de France.
Au prémices de la révolution, alors que les esprits sont déjà échauffés, c’est une pénurie de farine, à l’automne 1789, qui va mettre le feu aux poudres. Alors que les parisiens se retrouvent affamés dans la ville, le roi reste dans les splendeurs de Versailles, ce qui ne manque pas de provoquer la population. Les femmes, aux premières lignes en tant que gestionnaires des foyers et au prise avec l’alimentation, vont commencer à se regrouper place de Grève (actuelle place de l’Hôtel de Ville). On compte 5000 à 7000 femmes qui vont finalement décider d’aller réclamer elle-même la farine, directement auprès du Roi, à Versailles. Ce sera finalement l’occasion de demander le retour du Roi à Paris et la signature de la Constitution et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Ce trajet revet donc une symbolique populaire et féministe. De quoi au passage aussi chahuter l’image d’une révolution menée par des hommes…
La Place de la Concorde des Jeux Paralympiques
La cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques s’est déroulée Place de la Concorde, ce qui est déjà une symbolique toponymique en soi. Mais, plus qu’une simple histoire de nom et d’inclusion, il est intéressant de creuser encore les échos de ce lieu.
Cette place fut inaugurée en 1772, sous le nom de Place Louis XV. Chaque souverain a inauguré son lot de places royales, symbole de leur pouvoir. Mais en 1792, alors qu’elle est un lieu de rassemblements révolutionnaires, elle sera renommée Place de la Révolution, pour marquer le changement de régime. C’est l’occasion de fondre la statue du roi et d’utiliser cette tradition longuement ancrée d’utiliser la toponymie et l’urbanisme pour symboliser un pouvoir, l’ancrer dans l’espace, au vu et su de tout le monde.
Durant la Terreur, c’est sur cette place que seront guillotinés de grands personnages comme Marie-Antoinette et Louis XVI. En 1792, c’est justement pour tourner la page de cette sombre histoire française et marquer la réconciliation des français qu’elle obtiendra son nom actuel, Place de la Concorde.
Pour aller plus loin dans le symbole, 8 statues représentant 8 grandes villes françaises sont visibles sur cette place et le projet actuel est de la transformer en place-jardin. Un lieu qui n’en finit pas de symboliser révolution, hier politique et sociale, aujourd’hui sociétale et environnementale, comme un lien entre les français et leurs lieux.
Les Invalides de l’armée
L’hôtel des Invalides a servi de décor aux épreuves de tir à l’arc, mais quel est le lien exactement ?
Les Invalides ont été construits sur ordre du roi Louis XIV dans le but d’accueillir les invalides de l’armée du roi revenant de la guerre de Trente et qui commencent à créer du désordre dans Paris et à gêner la population. L’idée est de les soigner, mais aussi de les remettre dans le droit chemin moral. C’est un des seuls lieux de l’armée qui soit aussi ouvert au public et il restera un lieu de promenade parisien. Mais celui qui garantira la survie de l’établissement, c’est Napoléon. Son attachement à l’armée l’amènera à utiliser symboliquement ce lieu pour la première remise des Légions d’Honneur et c’est là que reposent ses cendres, ramenées en grande pompe dans Paris et au milieu de figures militaires importantes.
Mais quel est le lien entre tir à l'arc et armée ? Tout simplement la fonction première de cette discipline. En effet, le tir à l’arc est l’une des techniques de guerre les plus anciennes créée par l’être humain et celle qui détient probablement le record de longévité d’utilisation, même si cela nous semble obsolète aujourd’hui. C’est une technique de chasse utilisée pendant des siècles, voire des millénaires, bien avant les épées ou les armes à feu voire les technologies utilisées aujourd’hui. Le tir à l’arc aux invalides, c’est un retour aux origines de la pratique militaire et de l’invention de la discipline.
Et vous, avez-vous repéré l’écho de lieux aux Jeux Olympiques ou dans une autre compétition sportive ?